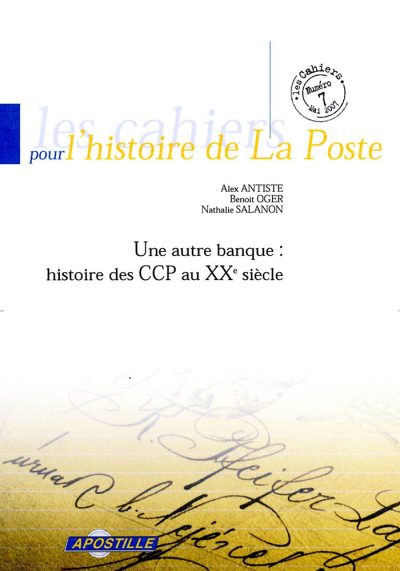Cette septième livraison des Cahiers porte sur l’histoire des Services financiers de la Poste, comme on les appelait avant que La Banque Postale ne vienne dernièrement les fédérer. Le nom de Banque Postale peut survenir ex abrupto en cette entrée éditoriale pour celles et ceux qui ne se sont jamais penchés sur l’histoire financière de la Poste. Il n’en est pas de même pour les quelques historiens qui ont travaillé sur ce thème, car ce nom est utilisé dès 1909 par les détracteurs du projet de création des Comptes chèques postaux (CCP). Il est vrai que c’est une histoire peu ou prou abordée par la communauté universitaire et survolée par les différentes associations historiques dont la Poste est l’objet de recherche. Autant les banques, qu’elles soient de dépôts ou d’affaires, et les Caisses d’épargne ont été étudiées et comparées, autant le champ de recherche que représentent les services financiers de la Poste est resté quasiment vierge de toutes investigations historiques.
D’où viendraient ces réticences ? Y aurait-il des sujets de recherche plus « nobles » que les autres ? La Poste a-t-elle suffisamment encouragé la recherche et ouvert ses archives ? On peut avoir différents avis sur la question, pour ma part j’y vois deux raisons principales. La première a trait au caractère administratif et répétitif des documents qui rebute bien souvent les chercheurs ; la deuxième est liée au fait que l’histoire des services financiers de la Poste – notamment tout ce qui touche à leur création – doit être envisagée de façon ample. Je veux dire par-là qu’on doit essayer autant que faire se peut de croiser à la fois le politique, le social, le juridique, l’économique et le financier quand on aborde cette histoire. Et l’articulation et la « problématisation » de ces différentes approches ne sont pas toujours aisées à réaliser par le chercheur novice. Les outils – guide du chercheur ‑ et les incitations – attribution de bourses ‑ mis en place par le CHP ont fort heureusement permis que de jeunes chercheurs se lancent dans l’aventure sans céder au découragement. Grâce à eux, la réalisation de ce Cahier dédié entièrement à l’histoire des Comptes chèques postaux a pu être possible.
Composée de trois parties, cette étude traite à la fois de la genèse des CCP (globalement entendus sous le sens de Centre de chèque postaux, mais aussi Comptes chèques postaux), du fonctionnement d’un de ces centres – celui de Paris -, et de la modernisation et informatisation des tâches qui incombent à chaque centre. La première partie met en avant les controverses soulevées par l’idée de créer un chèque postal en France. Avec la création de la Caisse nationale d’épargne, l’administration postale s’était déjà immiscée dans un domaine jusque-là réservé aux Caisses d’épargne privées. En créant les Comptes chèques postaux (CCP), elle deviendrait un acteur particulier dans le domaine financier français. C’est cette idée qu’il est difficile de faire admettre au début du XXe siècle. La grande majorité des libéraux de l’époque voulant cantonner l’administration postale à son métier d’origine, c’est-à-dire le transport des lettres et paquets.
D’autant qu’ils peuvent constater que lorsqu’il est sollicité le réseau postal fort de ses milliers de bureaux sait répondre aux attentes du public. Et ce qui avait été admis ‑ non sans débat ‑ dans le domaine de l’épargne vingt ans plus tôt, ne paraît pas souhaitable pour le développement du chèque. Car avec les CCP, l’administration postale entre de facto dans le domaine bancaire, et les banques ne sont pas prêtes à l’admettre et leur opposition perdurera tout au long du XXe siècle. Outre cette entrée dans le monde de la banque, le projet de création des CCP achoppe sur ce qui est considéré comme de l’interventionnisme étatique. Mais la guerre avec toutes les difficultés qu’elle engendre, notamment l’inflation fiduciaire, aura raison des oppositions et finalement le vote portant création des CCP est réalisé en janvier 1918. La loi ne donne pas exactement au chèque postal la même valeur qu’au chèque bancaire et il faut attendre les lois de 1940 et 1941 pour que le chèque postal soit traité à l’égal du chèque ordinaire, la loi de 1955 ne faisant qu’entériner cette assimilation. Là, encore, le contexte d’une guerre profite aux CCP et leur développement est vraiment considérable après 1945.
Face à cette expansion, l’administration postale va beaucoup recruter, notamment pour effectuer les différentes tâches des centres de chèques postaux. En 1954, Michel Crozier avait réalisé une étude sociologique sur les 4 000 personnes qui composaient le centre de chèques postaux de Paris, quarante-cinq ans plus tard. Alex Antiste reprend cette étude et s’appuie sur elle pour analyser l’évolution du centre pendant une forte période de croissance en terme de trafic. Avec deux millions de comptes en 1964, le centre de chèques postaux de Paris est le plus important de France. Les effectifs augmentent de 72 % entre 1945 et 1950. Et, en 1966, le personnel est six fois plus nombreux qu’en 1945. Ce personnel est principalement féminin et appartient aux catégories B et C de la fonction publique.
Alex Antiste s’interroge sur les origines géographiques et sociales de ce personnel d’exécution et révèle la prééminence du Sud-Ouest de la France dans ce recrutement.
Malgré un faible niveau de rémunération, les concours des PTT attirent toute une population aux origines modestes notamment issues de la petite fonction publique. Les conséquences de ce recrutement provincial débouchent sur des demandes de mutation pour un retour au « pays » le plus rapidement possible, et également, sur un taux d’absentéisme plus important à Paris qu’en province. L’auteur détaille également le travail des employées des chèques avec la standardisation des tâches, le travail en brigade qui octroi du temps libre ou permet la garde des enfants, mais bouscule les rythmes de vie avec des horaires complètement décalés. Face à l’augmentation de la productivité, l’activité syndicale du centre est intense et les grèves fréquentes nonobstant un faible taux de syndicalisation. Le fait que cette étude soit émaillée de témoignages de personnes qui ont travaillé au centre de Paris pendant la période étudiée en redouble l’intérêt.
Devant la masse des opérations à effectuer, l’administration postale s’emploie assez rapidement à informatiser les centres de chèques postaux, notamment en créant, en 1956, le comité consultatif d’organisation, de méthode et de mécanisation administrative. Nathalie Salanon nous précise les différentes étapes qui vont de la mécanisation avec les premières machines comptables au premier ordinateur IBM 650 puis au 1401 installé au centre de Rouen avant la fin de l’année 1961. Cet appareil assure la transition entre la technologie mécanographique et la technologie informatique. Il s’agit d’une informatisation partielle car seuls 4 000 comptes sur 200 000 subissent un traitement informatique, mais en 1964 l’ensemble des comptes est géré de cette manière.
Nathalie Salanon nous montre bien comment les divers perfectionnements apportés au fil du temps, non sans difficultés devant les choix technologiques à réaliser, bénéficient à l’ensemble des centres. En 1976, dix ans après les Pays-Bas, la gestion électronique des centres français est achevée. Cette étape informatique était évidemment nécessaire pour pouvoir traiter les 7,4 millions de comptes chèques postaux en 1980 et lutter à armes égales avec la concurrence qui s’était amplifiée dans les années 1970-1980. Au total, une étude qui embrasse une étude globale, tant sur le plan technique, qu’institutionnel et sociétal, des différentes étapes de l’évolution des chèques postaux, cette banque déjà pas comme les autres.
Benoit OGER