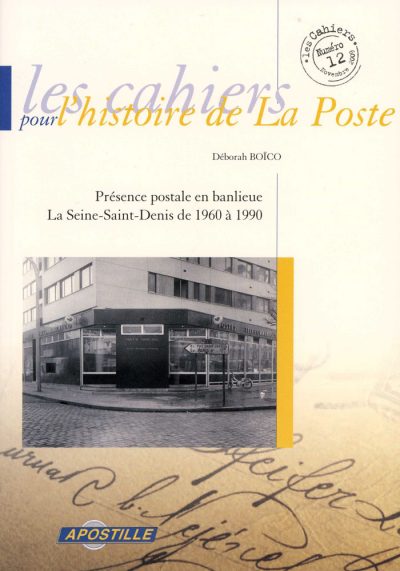Depuis plusieurs numéros, Les Cahiers pour l’histoire de la Poste ont pris l’habitude d’alterner les optiques (monographie / histoire globale, histoire sociale / histoire politique), et de se faire entrechoquer les approches et les problématiques. Pour ce n°12, ils n’y dérogent pas : après l’étude sur l’implantation rurale de la Poste au XIXe siècle dédiée au cas de l’Auvergne, opérons un basculement au XXe siècle et à la banlieue, avec ce travail de Déborah Boïco qui prend la Seine-Saint-Denis, département créé le 1er janvier 1968 sur les ruines du nord de la Seine et d’un morceau de Seine-et-Oise, comme laboratoire d’étude. Exemplarité d’un travail qui commence par analyser l’inadaptation de la présence postale à ce type d’urbanité soudainement émergeante, et pour cause, les bureaux de poste traditionnels des villes sont dans les centres historiques, et qui finit par décrire les moyens mis en œuvre par les PTT, en collaboration avec les collectivités, pour pallier les manques.
Le sujet abordé ici relève de la sempiternelle et consubstantielle relation que la Poste entretient avec ses territoires et ceux à toutes les époques : campagnes, villes, zones touristiques, espaces montagnards, banlieues, chaque type de territoire développe une sociologie depuis les usages postaux et les relations à l’espace public jusqu’à la prestation de service public qui a toujours historiquement posé des difficultés particulières à la Poste, difficultés auxquelles la Poste a toujours su répondre par une grande réactivité. C’est d’ailleurs, ce dont témoigne la bibliographie finale, l’un des sujets les mieux étudiés dans les revues sous cet angle de la relation entre la Poste et ses territoires aussi bien par les géographes, les sociologues, les économistes que les historiens.
Mais la France rurale à l’habitat dispersé du XIXe siècle, à laquelle on offre la tournée du facteur, et la France des années 1960 aux banlieues-champignons à très haute densité d’habitat, totalement dépourvues d’équipements postaux à l’origine, même apparemment différentes, n’en posent pas moins des problèmes identiques à l’administration : comment desservir l’usager et capter des sources de revenus ? En effet, l’administration des Postes, branche du ministère des Finances qui alimente les caisses de l’Etat, puis la Poste, intégrée au ministère des PTT qui se découvre des ambitions commerciales, possèdent la même force d’adaptation aux territoires pour surpasser les difficultés. De l’autre côté du miroir, l’usager qui devient client à partir des années 1970, se doit de composer avec les mutations. On lui propose des déclinaisons et des adaptations de la présence postale, à savoir le bureau muet, le bureau annexe ou le bureau mobile ; on lui fait découvrir l’usage des batteries de boîtes aux lettres installées dans le hall de l’immeuble au rez-de-chaussée. Le banlieusard se forme à des pratiques postales qui a l’époque, n’existent que dans son environnement, ou presque.
Cette trentaine d’années qui court jusqu’au nouveau statut de La Poste en 1991, est révélatrice d’une quête de positionnement d’une entreprise qui se doit de s’engager pleinement dans la démarche commerciale, tout en prenant garde à rester fidèle à son rôle sociétal. Ce positionnement est de plus mis en tension par les relations avec les interlocuteurs traditionnels de la Poste, les collectivités et élus politiques locaux, qui perçoivent alors avec difficultés les enjeux d’une telle évolution. C’est aussi un des enseignements du travail de Déborah Boïco qui met en lumière cette nouvelle donne.
Sébastien RICHEZ