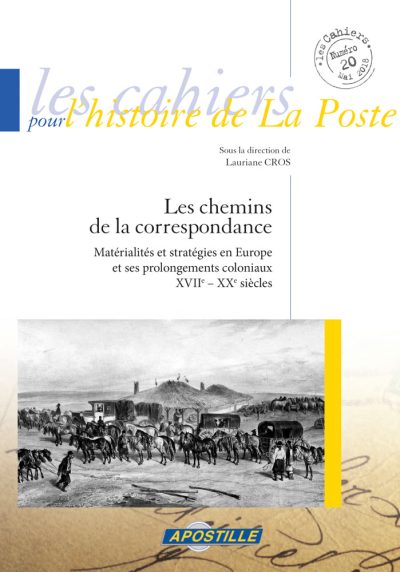En rédigeant l’article sur les lettres, dans l’Encyclopédie, le prolifique chevalier de Jaucourt souligna que l’écriture des billets, des missives ou des dépêches permettait aux hommes « de communiquer leurs pensées à des personnes éloignées ». Comparées avec celles de Cicéron avec « les matériaux les plus authentiques de l’Histoire » celles des modernes ne contenaient selon lui que « de petits faits, de petites nouvelles et ne peignaient que le jargon d’un temps ; pour les pays étrangers, elles ne regardaient que les affaires de commerce. Cependant en temps de guerre, les ministres qui avaient aussi l’intendance des Postes prenaient soin de les lire avant ». La méthodologie historique porte assurément désormais un autre regard sur la lettre qui « témoigne de la vie qui l’entoure, des conditions et des préoccupations politiques, religieuses, financières ou commerciales, intellectuelles ou culturelles »[1]. Le rôle des Postes était évidemment un préliminaire indispensable pour la construction d’un grand réseau de communication[2] soigneusement contrôlé et dont l’organisation était éminemment politique avec une tension de plus en plus forte entre le pouvoir d’État et l’émergence des libertés individuelles[3]. L’histoire de l’institution française réalisée de manière très classique par Eugène Vaillé, montre d’ailleurs que de 1629 à 1770 le surintendant général des Postes fut souvent le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, comme Colbert de Torcy ou Choiseul, ou alors le secrétaire d’État à la Guerre comme Louvois ou d’Argenson[4]. La seule direction de la Poste était assurément un indicateur des volontés royales aux yeux des pays voisins.
La lettre faisait l’objet d’un désir ou d’une impatience aussi bien pour les plus puissants agents de l’État que pour un particulier anonyme. Lucien Bély a pu rapporter les attentes de Torcy à l’égard des agents français présents à Londres pendant la guerre de Succession d’Espagne : « Ne condamnez pas mon impatience mais les nouvelles sont lentes à venir. Les lettres d’Angleterre nous manquent à cause du vent »[5]. Mais pour les individus le déplacement à la poste ou l’arrivée du facteur était un moment tout aussi attendu du quotidien. Le 4 mai 1775, à Mantoue, l’abbé de Guasco écrivit ainsi au fils de Montesquieu « depuis un temps infini je me trouve privé du plaisir de vos lettres, celle-ci vous parviendra sûrement car je la confie à un gentilhomme de Vérone qui va à Paris où il l’a mettra à la poste ». Au même moment la salonnière bordelaise Madame Duplessy fit « remettre un petit mémoire aux directeurs de la petite poste sur les lettres perdues et pour tâcher de recouvrer la dernière »[6]. Quelques mots envoyés demandant souvent une réponse décloisonnaient l’espace, ils favorisaient et accéléraient l’échange et donnaient alors naissance à une culture des lettres et à un réseau de correspondance. Les cas sont nombreux et celui d’Antonio Magliabechi est l’un des plus spectaculaires. Bibliothécaire du Grand-duc de Toscane Cosme III de Médicis à la fin du XVIIe siècle, il vivait largement en ermite mais partagea ses idées par écrit, pour un corpus de plus de 22 000 pièces, avec toute l’Europe savante[7]. Épistolier tout aussi prolixe, Voltaire utilisa le même moyen cependant pour cette fois un engagement public sans compter son temps afin de gagner des causes, pas toutes perdues[8].
Pour la transmission d’une information, la place des femmes était de toute évidence considérable d’une carrière à un mariage soigneusement négocié, comme le montre lors de cette journée d’étude plusieurs interventions. Elles pouvaient jouer un rôle d’intermédiaire mais chaque lettre apportant aussi une dimension personnelle, telle une fenêtre ouverte sur les secrets d’un individu, Philippe Martin a souligné que l’approche d’une correspondance « c’est souvent avoir l’impression d’entrer dans un lieu secret, de dévoiler les rêves et des affections »[9]. Cette journée peut être aussi l’objet d’un débat. Doit-on penser l’histoire de la correspondance à partir d’une étude globale, comme celle d’un corpus maçonnique, comme l’a pensé Pierre-Yves Beaurepaire, ou selon celle d’une micro-histoire imaginée pour un procès en sorcellerie par Carlo Ginzburg ? Une seule lettre peut soulever aussi des questions plus larges, les chemins et les raisons de la correspondance sont parfois tortueux. À Bordeaux, François Mauriac reconnut dans une préface « qu’aucun des personnages du Baiser aux lépreux n’est inventé, je pourrais mettre un nom sous chacun »[10]. En écrivant ensuite Thérèse Desqueyroux, publié en 1927, mis en film et étudié dans tous les collèges et les lycées, il n’hésita pas à utiliser abondamment l’exemple d’une famille de Saint-Symphorien mais alors au grand dam de sa cousine qui se chargea de le lui écrire aussitôt : « Mon cher François. Dès les premières minutes dans votre roman […] pourquoi placer des demeures ou des lieux si minutieusement décrits que nul ne peut feindre de les ignorer. Pourquoi surtout ces prénoms, ces minutieux détails qui peuvent amener des commentaires forts déplaisants »[11].
La transmission des lettres était attachée aux infrastructures postales routières et navales mais il n’y avait pas « de frontières infranchissables »[12]. Une lettre ordinaire mettait douze à quinze jours pour aller de Paris à Madrid au début du XVIIIe siècle, quatre de Paris à Londres, une vingtaine de Paris à Varsovie et le voyage outre-Atlantique vers les colonies était beaucoup plus incertain[13]. Une guerre ne devait pas interrompre les échanges selon les conventions internationales reconnues et le réseau ne cessa de s’étendre en fonction de l’ouverture européenne vers les autres mondes. Certes au XIXe siècle, les télégraphes et le télégramme purent remplacer d’une certaine manière les lenteurs d’un courrier, mais si Christophe Studeny a évoqué « l’invention de la vitesse »[14] Jay Caplan a saisi que la révolution des communications avait déjà depuis longtemps donné naissance à un postal world[15] et la lettre prit ensuite les airs[16]. Antoine de Saint-Exupéry engagé par la compagnie générale aéropostale pour transporter le courrier de Toulouse au Sénégal, puis en Amérique du Sud en 1929, sut en tirer ses épopées romanesques : Courrier sud (1929) jusqu’à Dakar où les paquets prenaient le bateau avant Vol de nuit (1931), et, qui sait, accélérer les échanges des hispanistes français avec les intellectuels de l’Amérique !
François CADILHON
[1] Beaurepaire, P.-Y., Häseler, J. et McKenna, A. (dir.), Réseaux de correspondance à l’Âge classique, Saint-Étienne, PU, 2006, p. 7.
[2] Le Roux, M. (dir.), Postes d’Europe, XVIIIe -XXIe siècles. Jalons d’une histoire comparée, Paris, Comité pour l’histoire de La Poste, 2007.
[3] Caplan, J., Postal cultural in Europe 1500-1800, Oxford, Voltaire Foundation, 2016.
[4] Vaillé, É., Histoire générale des Postes françaises, Paris, PUF, 1947-1955.
[5] Bély, L., Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris, Fayard, 1990, p. 136.
[6] Cadilhon, F., Les Montesquieu après Montesquieu, Tenir son rang du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, Pessac, MSHA, p. 131-132.
[7] Callard, C., « Diogène au service des princes, Antonio Magliabechi à la cour de Toscane 1633-1714 », in HES, janvier 2000, p. 85-103.
[8] Cadilhon, F., « Censure d’État, esprit public et raison privée », in Cadilhon, F., Chassaigne, P. et Suire, É. (dir.), Censure et autorités publiques, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 2015, p. 355.
[9] Martin, P. (dir.), La correspondance, Le mythe de l’individu dévoilé, Louvain, PUL, 2015, p. 17-18.
[10] Mauriac, F., Œuvres romanesques, Paris, La Pléiade, 1978, p. 1 120.
[11] Mars 1927. Fonds privés Lapeyre-Boissonnet.
[12] Beaurepaire, P.-Y., Pourchasse, P. (dir.), Les circulations internationales en Europe, 1680-1780, Rennes, PUR, 2010.
[13] On peut notamment se référer au projet de l’Université de Leyde des Sailing Letters capturées notamment dans les navires anglais ou hollandais de la fin du XVIIe siècle à celle du XVIIIe siècle.
[14] Studeny, C., L’invention de la vitesse. France, XVIIIe-XXe siècles, Paris, Gallimard, 1995.
[15] Caplan, J., op.cit., p. 167.
[16] On peut à cet égard prendre comme exemple les Cahiers pour l’histoire de la Poste : Henri, C., Le courrier prend les airs, L’aviation postale intérieure en France, n°15 ; Gosselin, C., Au temps de la très grande vitesse postale, n°16.