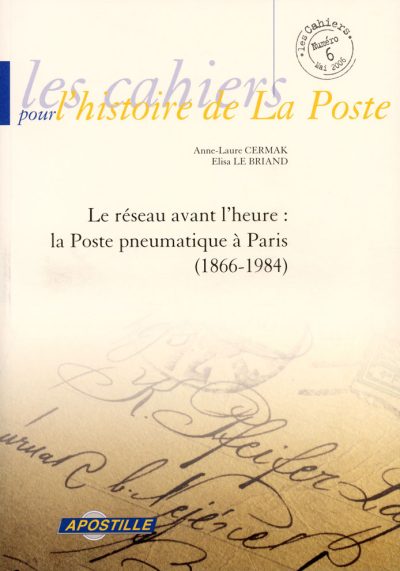Héron d’Alexandrie, sans doute au Ier siècle de notre ère, considérait les machines qu’il présentait ou inventait et qui, utilisent la contraction ou la raréfaction de l’air pour ouvrir automatiquement les portes d’un temple ou faire fonctionner une horloge, comme destinées à « susciter l’étonnement et l’émerveillement », et les distinguait de celles qui « répondaient aux besoins les plus nécessaires de la vie humaine ». Le premier mérite des études parallèles et complémentaires d’Elisa le Briand et d’Anne-Laure Cermak sur la Poste pneumatique, l’une surtout tournée vers les techniques, l’autre surtout sensible aux aspects économiques et sociaux, est de montrer la nature toute différente de l’intérêt que suscitent, au début du XIXe siècle, les propriétés dynamiques de l’air comprimé et du vide – dans le sillage de la machine à vapeur passée, de Papin à Watt, du statut de « curiosité » à celui de moyen de production. Dès les premières années du siècle, l’utilisation de l’air par les transports postaux est envisagée, moteur pneumatique ou action de l’air dans un tube (Murdock à Londres en 1800, l’ingénieur danois Medhurt à partir de 1810, etc…) ; alors qu’un visionnaire, Antoine Andraud (1795-1859) prévoit, en 1839, les multiples utilisations de l’air comprimé et estime même qu’il est appelé à remplacer l’or comme étalon universel, des inventeurs déposent des brevets, en vérifient l’efficacité par des essais publics – parfois concluants – que relate la presse, font édifier en France comme en Angleterre des lignes expérimentales, s’expriment devant des sociétés savantes. Ces premiers pas de la poste atmosphérique et l’esprit de progrès – voire les polémiques qui les accompagnent – sont comparables à ce que l’on peut alors observer dans d’autres domaines de la science et de ses inséparables applications ; l’ambition est grande, y compris celle de transporter des correspondances, mais aussi des colis, voire des passagers dans des tubes d’une taille plus conséquente, ce qu’on expérimentera, sans dommages, mais aussi sans lendemain, au début des années 1860, à Battersea, puis à Crystal Palace.
C’est en effet à Londres, que, dès 1853, Latimer Clark installa la première ligne de transport pneumatique de messages pour le compte de l’Electric and International Company – trois autres furent de même édifiées dans les années qui suivirent – ; celle-ci entendant ainsi relier la Bourse à ses proches succursales et éviter l’encombrement des lignes télégraphiques et les délais de transmission résultant de la nécessité de transcrire en morse des informations dont la disponibilité la plus immédiate était attendue. En France, où l’extension du télégraphe électrique avait été plus tardive, le réseau pneumatique parisien fut, comme le montrent les auteurs, également une extension, pour la même raison, du réseau télégraphique, mais résulta aussi de la volonté politique de Napoléon III de moderniser le pays et son capitalisme, voire de répondre au souhait plus large des parisiens et en particulier des entreprises et des notables, privés de petite poste, de pouvoir communiquer rapidement. On envoya donc un fonctionnaire enquêter sur les réseaux londoniens, trois ans avant de charger, en 1864, un fabricant de tubes de réaliser une première liaison, entre la Bourse et le Grand Hôtel, pour le compte de l’administration impériale du Télégraphe : brevet, essais, précision et modulations du projet, construction, tout cela fut réalisé entre le 31 janvier et décembre 1866 ; un prolongement vers la rue Jean-Jacques Rousseau et, rive droite, vers le centre télégraphique de la rue de Grenelle fut mis en service le 1er août 1867. Dans les années qui suivirent, tous les bureaux télégraphiques furent reliés par un réseau, composé de polygones censés éviter les encombrements du centre, il privilégiait la compression de l’air – et non le vide, comme à Londres -, qui était obtenue grâce à l’utilisation de l’eau, disponible et peu coûteuse, – et non par la chaudière à charbon et la vapeur, comme à Berlin, où la première ligne avait été ouverte dès 1865 – les tubes empruntaient le réseau d’égouts, que le Paris d’Haussmann devait, comme ses adductions d’eau, à l’ingénieur Belgrand.
Toutefois, pour Elisa Le Briand et Anne-Laure Cermak, qui citent des articles très critiques sur la lenteur du réseau et son encombrement en 1878, la principale originalité du pneumatique parisien découle d’une décision du 25 janvier 1879 – à peu près concomitante de la fusion en une administration unique des Postes et des Télégraphes et significative de son dynamisme, la création d’une « poste pneumatique » ; il échappe ainsi à son statut d’auxiliaire des télégrammes parisiens et son trafic et son produit sont presque multipliés par deux en un an : l’ensemble du public peut déposer des formulaires ouverts ou fermés – et bientôt à partir, de 1898, des lettres par exprès – avec un tarif très accessible ; le service – et le réseau – sont rapidement étendus à l’ensemble des arrondissements parisiens, et le service de distribution des plis renforcé : dès la fin de 1878, on expérimente le recrutement de « petits télégraphistes » âgés de 12 à 15 ans ; plus tard (en 1907), on étendra la distribution des pneumatiques à certaines communes de banlieue, mais avec des cyclistes à partir de bureaux parisiens – car seul Neuilly-sur-Seine bénéficie d’une ligne – puis des motocyclistes.
Comme le montrent les auteurs, et en particulier Anne-Laure Cermak, Paris n’est pas la seule grande ville à disposer d’un réseau de transmission pneumatique, ni même d’un réseau ouvert au public – dont disposent, outre Marseille et Alger, qui n’ont qu’une extension très limitée, Berlin et 7 autres villes allemandes, Prague ou New York, sans compter les villes où ce mode de transmission est réservé aux quelques professionnels, à Londres, dans trois autres villes anglaises, mais aussi dans les cinq principales cités suisses. Toutefois, avec 427 km de tubes en 1933, le réseau « pneumatique » parisien est le plus grand du monde ; il est alors bénéficiaire et dispose pour le chargement et la transmission des dépêches, leur distribution ou le fonctionnement du système, d’agents particulièrement qualifiés. Ce mode de communication postal discret et rapide, avec une remise au destinataire dans un délai de quelques deux heures, est bien intégré à la vie de la capitale et de sa proche banlieue pour les hommes d’affaires, les administrations, les gens pressés, les écrivains, les amoureux, voire les espions. Il connaît une utilisation record pendant la deuxième guerre mondiale : le trafic passe de 4 millions d’objets en 1940 à 16 en 1945.
Elisa Le Briand s’attache à l’étude des capacités de ce service public à se moderniser, en recherchant à la fois l’économie de moyens et la meilleure efficacité. Après des efforts pour réduire la consommation en eau, par des injecteurs imaginés par l’ingénieur Worms de Romilly – initialement spécialiste des machines à vapeur – et par des turbines, l’administration diminue le nombre de machines à air comprimé, puis introduit, en 1871, la machine à vapeur, avant d’en généraliser l’usage (1879) en retouchant progressivement l’ensemble du réseau : il est composé désormais de lignes à double tube, dont les têtes – les centres de force, elles-mêmes reliées entre elles – sont alimentées en air par neuf ateliers de force. De même, les terminaux d’où partent et où arrivent les dépêches comme les pistons, eux-mêmes, devenus boîtes à dépêches, sont améliorés pour répondre à une augmentation du nombre des envois, à la séparation des activités de contact avec le public et d’entrée ou de sortie du réseau, comme pour éviter les interruptions de la circulation des autres « trains » de la ligne pendant le chargement ou le déchargement, voire les erreurs. Les inventions sont dues à certains industriels, mais aussi à des cadres de l’administration comme l’inspecteur Gissot ; et l’installation d’une nouvelle entité est volontiers, comme pour le nouvel atelier de l’hôtel des Postes, inauguré en 1888, une occasion pour des innovations. Toutefois, dès les premières années du XXe siècle, on peut déceler des limites financières à leur généralisation, et cette situation est plus visible encore après la Grande Guerre : l’électrification des ateliers de force, décidée en 1927, s’étale jusqu’à la deuxième guerre mondiale. Certes, l’ingénieur Gaillard organise rationnellement le réseau à partir de 1932 avec des mesures de la circulation d’air, avec un service de maintenance qui diminue le nombre d’incidents ; mais son automatisation, dont la première application avait été réalisée en 1931 par une firme allemande, peut-être dans le cadre des réparations, ou parce que ses homologues françaises avaient pris du retard en la matière, bien que décidée à titre expérimental pour quatre lignes en 1935 et confiée à des entreprises françaises l’année suivante, se heurte à des difficultés, puis à l’état de guerre, avant d’être revue à la baisse en 1942 ; elle ne fut en fin de compte réalisée, avec des curseurs commandant eux-mêmes leur éjection, que sur la moitié du réseau. De même, les tubes en plastique, mieux adaptés à l’avancée des curseurs plus résistants, plus silencieux dans les bureaux, ne vinrent remplacer les tubes d’acier que tardivement – à partir de 1965 – et seulement à l’occasion d’interventions ponctuelles.
Elisa Le Briand et Anne-Laure Cermak, voient là des prémices du déclin du réseau, et de l’arrêt du service, décidé en 1984, tout en rappelant qu’en 1966, le Journal du ministère des PTT le présentait comme « un centenaire qui se porte bien. » Il est de fait, comme elles l’indiquent, qu’à partir des années 70 au moins, les incidents dus au blocage des curseurs augmentent, et que le réseau est particulièrement mal entretenu : en 1983, un peu plus de la moitié des lignes est inutilisable, et, dans les lacunes ainsi créées, les plis sont acheminés en surface, par des cyclistes ou des motocyclistes ; les installations avaient vieilli – et sans doute souffert des restrictions de la guerre – ; leur adaptation au rôle économique nouveau de certaines banlieues un temps envisagée sous forme d’extension des lignes est vite abandonnée dans un pays appauvri ; leur renouvellement lui-même eût été d’autant plus coûteux que le système s’étendait sur un vaste territoire, alors même que son exploitation entraînait un déficit croissant, même si les chiffres annoncés alors ont été contestés. Il s’explique par une désaffection du public qui s’accentue – de 4 millions au début des années 60, les envois passent de 2,7 millions en 1973 à 650 000 en 1982 -, et qui n’est pas seulement due à une baisse de la qualité de service (elle ne paraît guère critiquée par la presse) ni à une hausse des tarifs (qui passent pour la carte pneumatique de trois fois à cinq fois celui de la lettre en 1959), ni même à un certain oubli d’un service qui ne bénéficie d’aucune publicité (alors même qu’elle connaissait alors, en général, un fort développement), mais à un phénomène de société : il s’accentue lorsque les communications téléphoniques, qui avaient déjà presque doublé depuis l’avant-guerre à la fin des années 50, se multiplient après le VIIe Plan et le rattrapage du retard pris, et lorsque le télex, puis la télécopie sont mises à la disposition des entreprises, naguère grandes utilisatrices des « pneus ».
Toutefois, les auteurs, tout en rappelant que les réseaux comparables, notamment aux Etats-Unis, ont également disparu, considèrent que les télécommunications responsables de l’exploitation du système de transmission et la Poste, chargée de la réception et de la distribution, ont pour ainsi dire programmé la fin du pneumatique. Le fait qu’un même ingénieur soit resté pendant plus de quarante ans, entre 1932 et 1974, à la tête du réseau pneumatique est sans doute déjà le signe d’un certain isolement, voire d’un oubli au sein d’une administration dirigée par des polytechniciens de mieux en mieux formés aux modes les plus modernes de la transmission du signal, et désireux, comme le souhaitait du reste la population, de les mettre en œuvre. La dynamique des fluides, voire la mécanique étaient relativement délaissées, même si l’automation était à l’ordre du jour : l’air comprimé ou raréfié, avec ses vieilles machines, étaient éloigné des formes modernes du progrès, ne faisait plus rêver, comme au début du siècle précédent, et ce réseau comme du reste, celui du télégraphe, paraissaient des rivaux anachroniques et de plus en plus coûteux de ceux du futur ; cette impression s’affirma après le rapport Nora-Minc et lorsque la direction générale des Télécommunications proposa nombre de nouveaux services. La Poste, tout en se préparant à une éventuelle disparition de plus en plus souhaitée par son partenaire, était plus circonspecte : elle admettait certes que quelques 500 000 pneumatiques pesaient peu par rapport aux 14 milliards d’objets qu’elle traitait chaque année ; mais elle ne souhaitait pas perdre des clients au profit des télécoms, même si, au moment où la motorisation de la distribution s’étendait, les transports terrestres lui semblaient avoir plus d’avenir que les réseaux d’air comprimé ; elle disposait certes de services de substitution, encore jeunes, comme la télécopie publique, Posteclair, offerte sur tout le territoire, et Postexpress, et était très attentive à la meilleure gestion des agents motorisés de la distribution et au développement du courrier express, qui quelques mois plus tard fut confié à une filiale. La Poste défendait donc face aux télécommunications, le pneumatique, avec moins d’énergie, il est vrai, que le télégraphe. Le cabinet et le ministre lui-même estimèrent peu opportune la suppression de ce dernier service, certes en perte de vitesse, mais encore utile à bien des gens, et modernisable, et décidèrent l’arrêt définitif et du réseau strictement parisien de pneumatique, de moins en moins utilisé et pour ainsi dire irréparable, et pour le remplacement duquel, sur un territoire plus vaste, des services nouveaux étaient disponibles.
Les syndicats, dont Anne-Laure Cermak décrivent soigneusement les ultimes batailles en faveur de ce réseau, dénoncèrent le recul du service public – il conquérait, il est vrai, de nouvelles plages – ; les mouvements de protestation du public, contre lesquels on nous mettait en garde, ne se produisirent pas : la presse exprima surtout de la nostalgie, et je n’ai gardé le souvenir que d’une seule réclamation, celle d’un expéditeur, que l’arrêt du fonctionnement avait spolié de la distribution urgente qu’il attendait. Sans doute, y a-t-il eu perte de savoir-faire ; mais, comme l’indiquent ces études – et le confirment l’évolution des moyens de télécommunication – le réseau et sa conception étaient surannés dès lors qu’il ne prenait en charge que les lettres ; il eût fallu en fait un nouveau réseau – capable de transporter des objets postaux, colis compris, jusqu’aux centres de distribution, comme à Hambourg – ou se contentent de relier entre elles de grandes entreprises, comme dans les villes suisses. De tels projets n’ont guère été évoqués au moment de la suppression, car ni la Poste, ni les télécommunications n’avaient la volonté et les capacités de les mettre en œuvre, et l’on peut se demander aujourd’hui, à l’époque du courriel, si des investissements importants eussent été alors un choix judicieux – encore que l’on doive se demander si l’utilisation de réseaux souterrains, voire de l’air comprimé ne retrouveront pas un nouvel avenir, comme l’a suggéré la DATAR au moment où l’on s’inquiète de l’encombrement des centre villes et de l’augmentation du prix de l’énergie. On saura gré, en tout état de cause, à Elisa Le Briand et à Anne-Laure Cermak, d’avoir complété une lecture extensive des ouvrages et articles consacrés à la poste pneumatique à Paris, par la consultation et surtout l’analyse originale de nombreux documents d’archives – ou rassemblés par des collectionneurs ; elles donnent, pour leur premier travail de recherche, des synthèses intelligentes, qui abordent les évolutions de la technologie et de sa place dans la société, la prise en compte des besoins sociaux, l’histoire aussi des politiques suivies, de leur financement et des prises de décision tour à tour déterminées, s’agissant d’une administration, qui a prouvé son dynamisme, par la volonté de l’empereur, le pouvoir des ingénieurs et des grands commis, et la décision d’un ministre. Tout en dégageant les caractères spécifiques de cette aventure parisienne du « pneumatique », qu’elles confrontent à d’autres, ces jeunes historiennes ouvrent la voie à des recherches complémentaires qui permettront, notamment à partir des documents budgétaires et financiers, pour autant qu’ils soient disponibles, d’approfondir leurs conclusions.
François ARON
Ancien conseiller auprès du ministre Louis Mexandeau